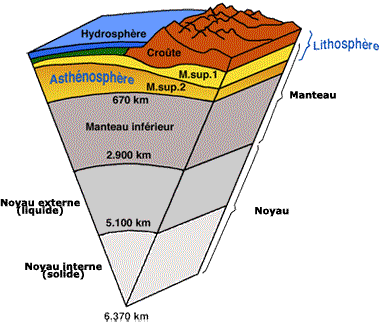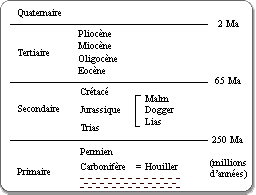Quelques notions préalables
Pour comprendre la géologie de l’Alpe d’Huez, ou de tout autre secteur des Alpes, il faut avoir en tête trois schémas :
- celui de la structure de la Terre (Fig.1)
- celui des principaux âges géologiques (Fig. 2)
- celui de l’histoire de l’Océan Alpin (Fig. 3 et 4)
La structure de la Terre
La Terre est un emboîtement de coquilles sphériques concentriques dont la répartition est indiquée sur la figure ci-contre. La fraction qui nous intéresse se situe dans la partie externe. Elle comprend :
- la croûte continentale (en orangé), principalement constituée de granite, une roche qui comporte essentiellement trois minéraux : quartz, feldspath et mica,
- la croûte océanique (en vert), moins épaisse, plus dense, à dominante de basalte, une roche surtout constituée de feldspath et de pyroxène,
- le manteau supérieur 1 (en jaune clair), formé de péridotite, une roche à base de pyroxène et d’olivine.
Il convient de noter que la croûte et le manteau supérieur 1 sont regroupés sous le nom de lithosphère, par opposition au manteau supérieur 2, situé juste au-dessous, qui est appelé asthénosphère. Cette distinction traduit le fait qu’une forte diminution de la rigidité se produit lors du passage de la lithosphère à l’asthénosphère (contraste physique), bien que les compositions chimiques des deux milieux concernés (manteaux supérieurs 1 et 2) soient à peu près identiques (analogie chimique).
Le jeu des plaques lithosphériques
La lithosphère, rigide, comporte une douzaine de grandes plaques qui, en dérivant, donnent lieu à la formation et à la disparition alternées d’espaces océaniques, une évolution qu’a connue la région de l’Alpe d’Huez. Voici, plus précisément, ce que fut son histoire, à l’échelle des temps géologiques.